"La maison la plus heureuse est celle qui ne doit pas ses richesses à l'injustice, qui ne les conserve pas par la mauvaise foi, à qui ses dépenses ne causent pas de repentir."
« Armate cives !»
La Cité n'est vertueuse que si elle est sage, courageuse, tempérée et juste.
Chers concitoyens,
Force est de constater que notre « bien commun », notre modèle
social, est de toutes parts contesté dans ses fondements, dans une indifférence quasi générale. La cause de cette désaffection profonde réside notamment dans le fait qu'aucune de ses quatre
vertus cardinales et fondatrices, que constituent la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, n’y est désormais plus observée. Il est donc vital, pour reconstruire la Cité, de se réapproprier les
fondamentaux que les anciens nous ont transmis.
Glaucon d'Athènes estime qu'une Cité est parfaitement bonne si elle est sage, courageuse, tempérée et juste. La sagesse s’appuie sur la connaissance, la justice
« confère à la tempérance, le courage et la sagesse, la capacité de se produire et garantit la sauvegarde de leur existence » et la tempérance doit lier sagesse et courage de
façon à ce qu’il y ait identité d’opinion entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés sur le point de savoir quels sont ceux qui doivent diriger.
Mais il ajoute que chaque citoyen tend naturellement
à devenir injuste et que le gouvernement de la Cité se voit obligé de créer la justice et les lois pour protéger ceux qui sont incapables d’être injustes et subissent les méfaits de
l’injustice des autres sans pouvoir en bénéficier des avantages.
Les principes et les règles de vie de la Cité sont construits sur les valeurs de liberté, d'équité, de solidarité
et d'unité. Ils aboutissent historiquement à la création de notre société. Aujourd'hui, plus que jamais, ces valeurs favorisent la cohésion du corps social et demeurent les piliers de l'idéal
républicain dont dépend notre avenir commun.
Rappelons brièvement ce qui définit ces notions parfois abstraites mais qui, in fine, sont bien ancrées dans la mémoire
collective et constituent la réalité de notre vivre ensemble.
République libre
L’idée la plus ancienne de la liberté nous vient de la démocratie athénienne, dont Aristote fait la théorie dans ses Politiques. Les citoyens
sont libres parce qu’égaux, c’est-à-dire qu’aucun ne peut commander à un autre, et par conséquent ils décident (dans l’assemblée) et participent à la magistrature
(ils sont gouvernants et gouvernés tour à tour). L’élection est même suspecte puisqu’elle est une forme de sélection des « meilleurs » et permet ainsi à certains hommes
de prendre de l’ascendant sur les autres ; elle introduit un élément aristocratique dans la démocratie. C’est pourquoi la démocratie athénienne lui préférait le tirage au sort. Ainsi la liberté,
c’est la démocratie directe, et une vie véritablement humaine, une vie libre, qui consiste dans la participation "en personne" aux affaires publiques. Être homme, c’est être citoyen : telle est la
conception de la liberté qui caractérise l’humanisme civique.
À l’opposé on trouve la conception libérale de la liberté. Si le politique n’est pas le lieu même de la réalisation d’une vie vraiment humaine, si l’autorité
politique n’est qu’un moindre mal que les hommes doivent accepter pour défendre leur vie et leurs biens, alors la liberté consiste tout simplement en la non-ingérence de l’État dans les affaires
de chacun. Pour Hobbes, l’État-Léviathan est rendu nécessaire par la menace de mort que fait peser sur chacun la liberté naturelle des autres. Mais, pour lui, la liberté et la loi s’oppose. La
liberté est l’absence de loi civile et la loi est contrainte. Hobbes se distingue des autres libéraux en ce qu’il conçoit la sphère d’action du « Souverain » (le pouvoir étatique,
quelle qu’en soit la forme, démocratique, aristocratique ou monarchique) très étendue alors que ses successeurs et critiques montreront que le souci de la sécurité peut être compatible avec un État aux
dimensions et aux pouvoirs plus restreints.
Mais au-delà de ces divergences, reste une problématique commune : nous ne sommes libres que pour autant que l’État
ne se mêle pas de nos affaires. Ainsi tant que deux individus s’accordent volontairement, quels que soient les termes et les circonstances de cet accord, la loi n’a pas à intervenir. Une telle conception libérale de la liberté
n’exige pas nécessairement un régime démocratique, les libertés essentielles n’étant pas les libertés politiques mais le droit de propriété et les autres libertés
civiles. De Benjamin Constant à Friedrich von Hayek, les libéraux n’ont pas caché leur méfiance face à la démocratie si prompte aux emballements égalitaristes.
La conception républicaine de la liberté - telle que l’ont explicitée ces dernières années plusieurs philosophes anglo-saxons (John Pocock, Quentin Skinner, Philip Pettit) -
prend en compte ces deux conceptions opposées de la liberté tout en les renvoyant dos-à-dos. De la liberté libérale, elle conserve le caractère décisif des libertés individuelles et civiles - la liberté
de conscience, la liberté de conduire sa vie comme on l’entend et même la liberté de se désintéresser des affaires publiques. Mais de l’humanisme civique, le républicanisme retient
l’importance de principe du gouvernement populaire et l’idée que la loi est l’instrument de la liberté - et non sa limitation. Selon Philip Pettit, la conception républicaine de la liberté peut
se définir ainsi : liberté comme non-domination.
Elle implique, premièrement, que l’État est nécessaire et son intervention
légitime dès lors qu’il s’agit de protéger l’individu contre toutes les formes de domination, y compris les dominations « librement consenties ».
La conception républicaine, en deuxième lieu, exige que les individus soient également protégés contre la « tyrannie de la majorité ». Autrement dit,
la démocratie, si elle suppose le pouvoir législatif du peuple, doit cependant disposer d’institutions protectrices qui assurent la prédominance de la loi - c’est pourquoi la tradition républicaine, de Cicéron
à nos jours, est favorable à un « gouvernement mixte » et à la séparation des pouvoirs.
Le deuxième
point signifie que la liberté républicaine ne peut trouver une forme stable d’organisation dans la démocratie directe. La démocratie directe joue un rôle essentiel dans les périodes d’effervescence révolutionnaire
mais il n’est ni possible ni souhaitable qu’elle devienne la forme permanente d’organisation de l’autorité politique. Le premier point implique une intervention étendue de l’État et de la loi contre toutes
les formes de domination, par exemple contre la domination qui naît du rapport asymétrique qu’est le rapport salarial - intervention qu’un libéral considère comme une aberration puisque le contrat salarial est le rapport
entre deux volontés libres. « Socialement radical et politiquement progressiste », ainsi peut-on, selon Pettit, qualifier l’idéal républicain.
République équitable
Indépendamment du droit en vigueur, la notion de justice appelle celle d'équité
et d'égalité des chances relevant plutôt du domaine de l'éthique.
L’égalité des chances est une exigence qui veut que le statut social des individus d’une génération ne dépende plus des caractéristiques morales, ethniques, religieuses, financières et sociales
des générations précédentes.
C'est cette vision de l'égalité des chances qui constitue l'un des fondements de la théorie de la
justice comme équité de John Rawls : « en supposant qu'il y a une répartition des atouts naturels, ceux qui sont au même niveau de talent
et de capacité et qui ont le même désir de les utiliser devraient avoir les mêmes perspectives de succès, ceci sans tenir compte de leur position initiale dans le système social. »
Si les individus
ne sont pas plus favorisés ou défavorisés les uns par rapport aux autres, alors seul rentre en compte l'effort individuel dans la distinction entre les individus. On peut alors considérer l'égalité
des chances comme favorisant le développement d'inégalités
justes, c’est-à-dire celles étant légitimées par les efforts personnels de l'individu. De plus Rawls subordonne le second principe de la justice par rapport au premier principe qui scelle la « priorité
de la liberté » selon laquelle « la liberté ne peut être limitée qu’au nom de la liberté elle-même ».
Pour Patrick
Savidan, philosophe et Président de l'Observatoire des inégalités, l'égalité des chances
suppose que des moyens importants (santé, logement, éducation, formation, ...) soient socialement mobilisés pour que chaque nouvelle génération et chaque individu au sein de cette génération ait une chance égale.
Dans Repenser l'égalité des chances (2007), il souligne qu'une conception très individualiste de l'égalité des chances ne permet pas d'atteindre cet objectif, mais tend au contraire à renforcer les inégalités.
Pour que l'égalité des chances devienne « soutenable », il faudrait selon lui qu'elle produise « des rapports sociaux qui ne rendent pas impossible l'égalité des chances ». Il propose
pour cela de l'inscrire dans une perspective plus solidariste.
L'équité permet une discrimination
positive adaptant les conséquences de la Loi (souvent générale) aux circonstances et à la singularité des situations et des personnes (spécificités historiques, socioculturelles liées aux passés
et cultures individuelles).
Le sens humain de l'équité, lié aux idéaux d'impartialité et de protection du bien commun, a longtemps été une énigme évolutive car semblant aller à l'encontre des intérêts à court terme d'au moins une partie des individus, notamment
dans un monde réputé dominé par des processus de concurrence, de compétitivité
ou du « struggle for life ».
Justice sociale
La justice sociale vise à l'égalité des droits et à la solidarité collective.
C'est essentiellement une projection
vers une société plus juste, en admettant qu'il y ait toujours des injustices. On peut le voir soit comme une utopie, soit comme une démarche allant vers plus de progressisme. Les actions ayant pour objectif la justice sociale visent à donner à chacun les mêmes chances de réussite tout au long de leur vie, on parle alors d' « égalité des chances ». Les corrections nécessaires peuvent être sociales, financières ou culturelles.
La justice sociale peut se définir de manière négative : est injuste ce qui n'est pas acceptable socialement. Par exemple, les inégalités de salaires entre métiers de qualifications différentes sont
le plus souvent considérées comme justes, parce qu'elles sont socialement acceptées par la majorité. Il existe une distinction entre justice sociale (ou équité)
et égalité. La justice sociale est aussi une notion qui évolue dans le temps, ce qui est juste socialement peut devenir injuste
si le contexte change.
Dans son ouvrage majeur Théorie de la justice de 1971, le libéral
John Rawls écrit qu'une société est juste si elle respecte trois principes, dans l'ordre : 1) garantie des libertés de base égales pour tous ;
2) égalité des chances ; 3) maintien des seules inégalités qui profitent aux plus défavorisés.
Équité horizontale
Le concept d'équité horizontale stipule que deux personnes dans la même situation devraient avoir les mêmes droits et obligations. Il est donc proche du principe d'égalité :
« à situation égale, prestations égales » et il s'oppose aux discriminations. On retrouve la notion aristotélicienne de justice commutative.
Équité verticale
L'équité verticale cherche à réduire les écarts de niveau de vie entre les individus. Elle vise donc à ce que les plus riches contribuent davantage que les plus modestes. On parle aussi de justice distributive.
En considérant l'utilité, c'est-à-dire le bien-être
qu'auraient apportés les biens achetés grâce à l'argent tiré des revenus, Richard Musgrave distingue trois conceptions de l'équité
verticale:
- le sacrifice absolu égal (SAE) : même sacrifice d'utilité pour chacun.
- le sacrifice proportionnel égal (SPE) : chacun doit sacrifier la même fraction de l'utilité totale qu'il
aurait pu tirer de son revenu initial.
- le sacrifice marginal égal (SME) : les impôts et prestations doivent être tels que l'utilité marginale de tous les revenus devienne égale après ces transferts.
John Rawls a introduit en 1971 le "principe de différence" (ou maximin) en spécifiant que l'optimum de justice sociale était atteint quand la situation des
populations les plus défavorisées était la meilleure possible. Cette conception s'oppose à une vision égalitariste de la justice sociale.
Solidarisme : solidarité sociale
La question sociale, que le progrès continu des libertés publiques ne suffira pas à éteindre, pose à la démocratie cette
équation qu’elle n’a toujours pas résolue aujourd’hui. Comment la conquête de la souveraineté politique, comment une société qui en droit pose les hommes comme étant égaux entre eux,
peuvent-elles modifier très concrètement les conditions de vie, réduire les écarts de fortune ou de conditions entre des citoyens également libres ?
Désormais, comme le note Jacques Donzelot dans L’Invention
du social : « En se rencontrant pour la première fois, l’idéal républicain d’égalité, de liberté et de fraternité et la forme démocratique dessinée
par les contours du suffrage se revendiquant comme universel, conduisent à l’éclatement du droit comme instrument privilégié de l’organisation républicaine de la société. Le droit rassemblant des
citoyens égaux contre les privilèges de quelques-uns ne rassemble plus, mais divise et il divisera sur cette question du droit au travail. »
Ainsi donc l'étude de l’homme, non plus comme l’homo
œconomicus sur lequel l’ancienne école bâtissait des déductions, mais comme membre d’une société dans laquelle la vie commune crée des dépendances réciproques et
l'application aux lois économiques et aux améliorations sociales d’inspirations issues d’une autre source que le pur intérêt résument les deux tendances qui servent de point de départ à la théorie
de la solidarité.
À certains égards, la solidarité est un fait ou une loi si générale et si fatale que ses manifestations parfois ne nous frappent plus. Elle nous est devenue trop familière.
La division du travail, l’échange, la concurrence même sont, avec les associations professionnelles, les formes de cette dépendance mutuelle à laquelle sont soumis les hommes, sans laquelle aucun d’eux
ne pourrait subsister, qui est tellement liée au progrès lui-même qu’elle s'accroit à mesure que la société se développe.
Les sociétés humaines ne sont pas de simples organismes
soumis aux forces aveugles. Tout en vivant et en évoluant suivant des règles que la science peut formuler, elles portent en elles-mêmes un élément supérieur, pensée, conscience, volonté, liberté,
qui, dans de certaines limites, enlève à ces règles leur caractère imperturbable et en modifie le jeu.
« La nature, dit Léon Bourgeois, a ses fins à elle, des fins qui ne sont pas les
nôtres. L’objet propre de l’homme, c’est la justice, et la justice n’a jamais été l’objet de la nature ; celle-ci n’est pas injuste, elle est ajuste. Il n’y a donc rien de
commun entre le but de la nature et celui de la société… La solidarité est une loi, comme celle de la gravitation. on peut s’emparer de ces lois de la solidarité naturelle, dont les conséquences
peuvent être injustes, pour réaliser la justice même… La notion de la responsabilité mutuelle de tous les hommes dans tous les faits sociaux n’avait pas été aperçue jusqu’à
ce que fut introduite l’idée nouvelle de solidarité biologique. Elle établit entre l’individu et le groupe une complexité nouvelle de rapports. … Mais s’il y a eu échange
de services à toutes les heures du passé, s’il y en a à toutes les heures du présent, si cet échange a été tel que les uns sont comblés et les autres privés de tout, que ceux-ci ont profité
largement et que ceux-là n’ont rien reçu,... Ne sentez-vous pas qu’il faut mettre à jour la récapitulation des services échangés, établir la balance des profits et des pertes ? Ne sentez-vous
pas qu’il y a un compte social à établir ? »
Ainsi, l'existence d’une association de fait impliquant des obligations réciproques, d’un patrimoine
commun, moral et matériel, le maintien de l’équilibre et le compte social à faire entre les associés fondent la doctrine de la solidarité.
Elle modifie la notion
de la responsabilité. C’est à elle, en effet, que nous devons de voir entrer de plus en plus, dans l’appréciation de la moralité des actes, les facteurs externes : organisation sociale, milieu,
atavisme, éducation, habitudes. Certes, on en fait parfois quelque abus, quand on s’en tient à une vue superficielle des faits et à une étude sommaire des caractères. Il est trop commode de ne considérer dans
nos actes que les influences qui limitent notre liberté, sans laisser à celle-ci le rôle qu’elle conserve dans la direction de notre vie.
L’idée de solidarité modifie en second lieu celle de liberté ;
une société, dit-on, a existé avant nous et subsiste encore, dont tous les avantages sont inégalement répartis, parce que la solidarité de fait produit parfois des résultats qui ne sont pas
conformes à la justice. On ne peut admettre que ceux qui ont été les plus favorisés par le hasard de la naissance puissent traiter librement, en usant sans entraves de la supériorité qu’ils tiennent du passé,
avec ceux de leurs semblables moins bien dotés par la chance. Ce serait la lutte indéfinie du pot de terre et du pot de fer.Une pareille conclusion est contraire à l’idée de société.
Mais avant d’établir entre les hommes un rapport simple d’égalité pour l’avenir, il faut commencer par rétablir
entre eux l’équivalence de situation qui a été faussée par la manière dont se sont produits jusqu’ici les phénomènes économiques. Il faut régler entre les membres d’une
même société un compte qui leur permette de se considérer comme ayant toujours été de vrais associés.
Il y a une part de notre liberté, de notre propriété, de notre personne même
dont nous sommes redevables à l’effort commun des générations antérieures et de nos contemporains. Il ne suffit pas de constater le fait et d’y voir une merveilleuse loi d’harmonie qui lie toutes
les existences humaines ; cette réflexion amène à reconnaître le principe d’une dette. On n’est un être social qu’autant qu’on l’accepte et qu’on consent à
l’acquitter.
Qu’on ne voie pas là une négation de la liberté et de la propriété individuelles ; celles-ci subsistent, non, il est vrai, comme des dogmes intangibles autour desquels rayonnent, dans
un ordre subordonné, tous les autres principes sociaux et que toutes les institutions réunies doivent avant tout contribuer à consacrer et à maintenir, mais comme le but de nos efforts, comme des biens dont nous ne serons investis
légitimement qu’après l’acquit de nos obligations sociales.
Ces principes posés sur ce qu’il faut entendre par l’être social et la vie sociale, on
aperçoit que le moyen de réaliser la justice, c’est le contrat, c’est-à-dire l’association consentie, mutuelle et solidaire entre les hommes, « dont l’objet est d’assurer à
tous aussi équitablement que possible les avantages résultant du fonds commun et de garantir tous, aussi équitablement que possible, contre les risques communs. Le nœud de la vie sociale, c’est ce contrat ».
L’hypothèse de Rousseau place le contrat à l’origine des choses, tandis que la doctrine solidariste le propose comme un objectif naturel, d’accord en cela avec l’observation faite par les philosophes
modernes du droit, que le progrès de l’humanité se mesure à l’extension prise par le contrat dans les choses humaines. C’est ainsi que le contrat social, historiquement parlant, serait, comme l’âge
d’or, non le début, mais la fin de la société.
C’est à la fois un contrat privé, parce qu’il règle un échange de services entre individus ; collectif,
parce que les individus sont réunis en association ; mutuel enfin parce que, ne pouvant fixer des services dont il est impossible de calculer à l’avance la valeur, des risques et des avantages qui dépendent
si peu de notre volonté, on arrive à cette idée simple que si chacun de nous est seul pour se protéger, il sera écrasé.
Si la solidarité assure la persistance du progrès, c’est
l’effort individuel qui le crée.
La vie de l’humanité n’est qu’un mélange ou plutôt une lutte entre ces deux forces primaires : l’une de conservation, l’autre de progrès.
Il n’en est pas moins vrai que l’individu, après avoir reçu l’empreinte de son milieu, réagit sur lui comme un ferment plus ou moins énergique. La condition humaine s’améliore uniquement grâce
à ceux qui luttent, non à ceux qui cèdent passivement.
On dispute souvent de nos jours sur ce qui fait la force et la faiblesse de telle ou telle nation, et on arrive vite à cette conclusion que toute supériorité,
même dans le domaine purement économique, a son origine dans des qualités morales.
La doctrine de la solidarité repose sur la théorie de la « dette sociale »
et du « quasi-contrat ». « Sur le constat que la Révolution française et la déclaration des Droits de l'Homme ont consacré un individualisme et proclamé
— dit Léon Bourgeois — une fausse liberté. » Or l'homme n'est pas une abstraction, mais un être concret qui a des obligations, des devoirs et qui est dépendant de ses relations avec les autres (influence
du sociologue Émile Durkheim).
Ainsi, tout être se trouve être redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont ouvert à l'existence
(parents, professeurs, la société et tous les groupes concernés). Chaque homme doit donc « payer sa dette » et la solidarité
devient un droit, elle est aussi un devoir auquel l'État doit obliger légalement chacun à contribuer. Pour ce faire, Léon
Bourgeois propose la mise en place d'un salaire minimum, d'un système d'assurances
protecteur (en cas d'accident, de maladie ou de chômage), de l'impôt sur le revenu (pour participer à l'entretien des services communs),
d'un enseignement entièrement gratuit.
Les pères fondateurs de la doctrine solidariste, Hippolyte Maze, Jules Arboux, Léopold Mabilleau et
Léon Bourgeois, sont tous préoccupés de donner à cette
nouvelle république naissante les fondements théoriques qui lui permettront
de s’imposer durablement face à ses concurrents libéraux et marxistes. En Belgique, dans les années 2000, l'Union Nationale des mutualités socialistes s'inspira de cette référence pour le choix du nom de ses
mutualités
"Solidaris".Les solidaristes comptent parmi les initiateurs de nombreuses propositions de lois, dont certaines furent adoptées : 1890 : Suppression du livret ouvrier ; 1893 : Loi reconnaissant à « Tout Français ne bénéficiant pas de ressources financières la possibilité
de recevoir gratuitement une assistance médicale chez lui, ou à l'hopital, si c'est nécessaire » ; 1898 : Loi instituant un dédommagement pour les ouvriers victimes d'accident du fait des machines ;
1901 : Projet de loi sur le droit à la retraite qui aboutit à la loi
de 1910 avec d'importantes modifications du fait d'une opposition conjointe des patrons et ouvriers.
Les idées solidaristes contribuèrent également à l'évolution des esprits en faveur des divers régimes
d'allocations familiales, de la réduction
du temps de travail des femmes et des jeunes gens.
Mutualisme social
La solidarité sociale s'exprime aussi au travers de l'existence de sociétés
mutuelles.
En Grèce antique, Théophraste, philosophe
péripatéticien du IVe
siècle av. J.-C., a écrit qu'il existait chez les Athéniens et d'autres états
des associations ayant caisse commune que leurs membres alimentaient par le paiement d’une cotisation mensuelle destiné à donner des secours à ceux qui avaient été atteint par une adversité quelconque.
Le mouvement encourage et aide ceux qui fournissent des prestations mutuelles contre les risques en effectuant un paiement régulier ou une contribution.
Le mutualisme, institutionnalisé à travers des fonds communs
de placement, a été universellement reconnu comme un générateur de prévision classique et moderne des systèmes de sécurité sociale, et coexiste actuellement avec eux, bien que la chute de la popularité des fonds communs de placement dans de nombreux environnements sociaux
ont coïncidé avec le début du système public de sécurité sociale dans les premières décennies du XXe siècle.
Aujourd'hui, le mutualisme est lié à des sociétés financières, des assureurs,
des syndicats, des entités pour promouvoir l'économie
solidaire, les associations commerciales et des mouvements religieux. Le signe caractéristique du mouvement mutualiste est sa neutralité institutionnelle en matières politique et religieuse. Les coopératives et le mutualisme ont des points en commun, autour par exemple de l'idée d'entraide professionnelle.
Par ailleurs les sociétaires, malgré leur droit de vote, n'ont en fait qu'un pouvoir limité sur le fonctionnement et les prises de décisions face à une technostructure et une administration totalement maîtrisées
par un pouvoir central : « la démocratie participative n'a que peu de consistance sur les prises de décisions dans les conseils. »
République Unitaire
Il est clair qu'aujourd'hui les intérêts des communautés prévalent sur l’exigence républicaine d’assimilation
des individus, quelle que soit leur origine, et que, pour cette raison, la nécessaire unité de la Cité est menacée d'éclatement.
Or pour Platon, le plus grand mal pour la
Cité est celui qui la déchire et la morcelle, et le bien le meilleur celui qui lui assure son unité. Ce que les citoyens possèdent le plus en commun est ce qu’ils désignent en l’exprimant individuellement comme
« ce qui est à moi » et c’est par ce qu’ils possèdent en commun qu’ils ont une parfaite communauté de peine et de plaisir.
Pour redonner sens à
cette communauté de destin et infléchir la valence communautariste qui sape naturellement les fondements de la Cité, le politique a le devoir de proposer et de mettre en oeuvre un nouveau
projet de vivre ensemble dont l'objectif est clairement de rétablir la cohésion du corps social et d'aboutir à une volonté commune d'unité.
Cohésion nationale
L’unité de volonté qui permet à notre communauté d’envisager ensemble son destin est l’aboutissement
historique qui nous a permis de constituer sur un même territoire une unité d’existence parvenue à la pleine conscience de soi qui se traduit dans la langue, la culture, les intérêts communs.
Lorsqu’un groupe de personnes agit pour atteindre un certain but, ce groupe doit impérativement faire preuve de cohésion dans ses démarches. Cela est le cas d’une équipe sportive ou d’une association. Il en
est de même pour notre société, qui se trouve aujourd’hui devant la nécessité de résoudre un certain nombre de problèmes.
La résolution de ces problèmes nécessite impérativement
la cohésion du corps social, de même qu’un certain consensus du corps politique, pour que soient prises les orientations adéquates, et que les dispositions adoptées et les dispositifs mis en œuvre trouvent
leur pleine efficacité et aboutissent à un succès réel.
Chacun est en mesure, avec un minimum de réflexion, de se convaincre de cette nécessité. Mais une fois cette conviction acquise, il reste
à savoir jusqu’à quel point la cohésion peut se faire dans le peuple, et dans quelle mesure le consensus peut être établi au niveau du politique.
Le propre de toute évolution historique réside dans le
fait que les rapports entre les hommes changent au fil du temps et passent par différentes phases. Il y a donc forcément progrès des idées, car la nécessité de vivre ensemble oblige à surmonter
les relations conflictuelles, ou en tout cas à leur donner des formes nouvelles et mieux maîtrisées. Ce cheminement historique se fait tout au long d’étapes diverses, il peut connaître des moments de stagnation, d’avancée
rapides ou de ralentissement.
La valorisation de l’identité culturelle vient consolider les éléments objectifs et subjectifs qui rendent possible la cohésion, pour nous permettre d’exister et aussi résister
contre de nouvelles menaces. Ceci se comprend d’autant mieux si l’on prend en considération que ce qu’il est convenu d’appeler « la modernité », tout en apportant des éléments de confort
et de consommation de masse, sans résoudre véritablement la question de la qualité de la vie, génère de nouveaux problèmes graves qui menacent l’équilibre de la société tels le chômage,
l’exclusion, la drogue, la délinquance, le stress, les déséquilibres psychologiques etc.
Le premier niveau de cohésion est la cohésion d’opposition, c’est-à-dire
la manière dont un groupe resserre ses liens quand il entre en conflit avec un autre. Dans ce cas le facteur principal c’est le conflit, la menace de l’extérieur. L’unité se fait en réalité sous l’effet
d’un facteur externe.
Cependant, il faut reconnaître que cette manière d’établir le lien d’une communauté comporte une certaine limite, dans la mesure où elle est surtout réactionnelle.
Les individus ne se reconnaissent positivement qu'à travers une identité propre, un ensemble culturel, qui comprend aussi bien les manières de vivre que les œuvres spirituelles, patrimoniales, littéraires,
artistiques.
A partir de la reconnaissance de l’identité culturelle, la communauté historique forme un ensemble. Cela se traduit par la reconnaissance du fait que nous partageons ensemble quelque chose qui est à
nous, et qui est le produit de notre histoire. On le voit à travers l’impact des démarches patrimoniales concernant aussi bien les éléments architecturaux que les pratiques artisanales, qui ont façonné une part
importante de notre rapport au monde. Il s’agit donc d’une attitude qui augmente la cohésion car elle englobe quasiment toutes les composantes de la société, institutions, associations, individus, entreprises.
C’est
de la même manière que, sur le plan spirituel et intellectuel, se manifeste la reconnaissance de la valeur de nos écrivains, de nos penseurs, de nos artistes dans divers domaines. La volonté de préserver le cadre naturel de
vie, le patrimoine naturel, paysages, forêts, mangrove, littoral etc. fait également partie de cette prise de conscience d’une manière d’habiter le monde.
Ainsi la cohésion d’identification,
ou encore cohésion culturelle apparaît comme nettement supérieure à la simple cohésion d’opposition, parce qu’elle traduit un vouloir vivre ensemble, et cet ensemble garde sa cohérence même
si les individus ont entre eux des désaccords à des niveaux divers. Cependant, la cohésion culturelle ne débouche pas forcément sur la mise en œuvre d’actions permettant d’éprouver effectivement la
solidité de la cohésion. Elle court alors le risque de ne rester qu’une simple velléité, voire une illusion.
L’épreuve de vérité pour la cohésion, c’est
la perspective d’une action concrète, en vue de la résolution d’un problème. En effet, s’il est nécessaire de savoir rejeter ce qui ne nous convient pas, de bien connaître notre identité, tout cela
ne prend son sens, en définitive, que dans la perspective d’agir pour la résolution de nos problèmes.
La perspective de résolution s’exprime alors dans la notion de projet. Tout projet requiert par définition
la parole préalable, par laquelle les intentions des uns et des autres sont harmonisées. Et quand le projet est lancé, quels que soient les différences et les difficultés, chacun comprend la nécessité de s’entendre
pour faire avancer les choses. Il faut alors préciser que l’élément moteur qui déclenche l’élaboration du projet et sa mise en œuvre, c’est le politique. Et c’est la perspective de la cohésion
nationale qui donne au politique la motivation pour mettre en œuvre le consensus qui débouche sur la résolution.
De tout cela, il ressort précisément que la cohésion nationale et le consensus politique, malgré
toutes les difficultés et les freins qui s’y opposent, demeurent les conditions fondamentales de l'unité de la Cité.
La cohésion sociale, comme facteur d'unité, favorise le bon fonctionnement
de la société où s'exprime la solidarité entre individus et la conscience collective. Elle s'oppose à l'émeute, à la révolution, à la révolte.
Elle s'obtient par la confiance envers
les institutions et la confiance horizontale qui consiste à disposer d'un capital social, c'est-à-dire de pairs à même de fournir des entraides sans en attendre un retour immédiat, par exemple dans le cadre
de réseaux ou d'associations (chorales, clubs de football, etc.). De tels réseaux facilitent également l'investissement dans la vie publique. À ce titre, les associations
culturelles, sportives ou autres sont des acteurs qui favorisent la cohésion sociale.
(Le thème de la cohésion sociale est développé dans un autre chapitre.)
Corps social
La Société, à laquelle nous appartenons et que la sociologie s'est donnée
pour vocation d'étudier scientifiquement, est à proprement parler une communauté.
Littéralement « communauté politique », notion dont les plus anciennes traces se trouvent chez
Aristote et traduit en latin en « societas civilis » par Cicéron, elle
sert à définir l’unité politique de la Cité. Elle est « le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, largement autosuffisant
et autonome de l'État ».
Le corps social s'entend, par opposition à la classe politique.
Il représente la société civile, il est avant tout la totalité
des citoyens d'un État-nation ou, maintenant, de l'Union européenne. Dans
la pratique, ceux-ci agissent individuellement dans le cadre associatif. Une telle association peut être considérée comme représentative à condition qu'elle ait été constituée sur la base de la volonté
et des propres intérêts des citoyens se déclarant formellement et juridiquement membres de l'association.
Il y a dans cette conception le risque d'une certaine confusion entre la société comme ensemble des citoyens et des organisations censées représenter leur volonté, surtout quand certaines d'entre elles prétendent incarner l'ensemble des citoyens et s'attribuent ainsi
une légitimité de représentant de « la » société civile en général.
Pour qu'une telle
association ou organisation soit en effet une partie active et l'expression de la volonté de citoyens, il s'avère nécessaire que les associations formant la société civile disposent d'une structure et d'une forme d'action
intérieure tout à fait démocratiques. Ces nécessités excluent par conséquent des organisations qui ont été constituées par l'État, l'économie ou des églises.
Selon Roberto Esposito : « La communauté n'est pas une propriété, un plein, un territoire à défendre et à isoler de ceux
qui n'en font pas partie. Elle est un vide, une dette, un don (tous sens de munus) à l'égard des autres et nous rappelle aussi, en même temps, à notre altérité constitutive d'avec nous-mêmes. »
Le corps social sous-entend la notion de partage de valeurs communes, et particulièrement la solidarité, et
désigne couramment un ensemble d'êtres humains vivant sur le même territoire ou ayant en commun une culture, des mœurs, un système de gouvernement. Ceux-ci forment à un moment donné une communauté partageant
majoritairement un sentiment d'appartenance durable, une communauté de destins. Ce sentiment d'appartenance peut venir de l'une au moins de ces caractéristiques : un passé commun, réel ou supposé,
un territoire commun, une langue commune, une religion commune, des valeurs communes, un sentiment d'appartenance.
Avec le développement des nationalités au XIXe siècle,
la notion est liée à une construction politique : un groupe social reconnu ayant des droits politiques
spécifiques, voire le droit de former une nation souveraine.
Etat unitaire
L'organisation de l'État-nation qui sert l'intérêt général est unitaire car
les citoyens qui en sont les ressortissants sont soumis au même et unique pouvoir souverain. Il ne comprend qu'un seul appareil d'État pleinement compétent sur l'ensemble du territoire, tant sur le plan politique que juridique.
L'État unitaire est en théorie, centralisé : la gestion des services publics et l'administration des collectivités publiques infra-étatique est réalisée depuis la capitale.
La France était traditionnellement considérée comme un État unitaire centralisé, même si depuis 2003, la Constitution précise que son organisation est décentralisée.
Cette
notion doit être précisée et ne doit pas être confondue avec la déconcentration. La centralisation peut se teinter d'une déconcentration : en vue d'alléger la tâche de l'administration
centrale, et de donner à la population des interlocuteurs, le pouvoir central désigne des représentants locaux (préfet, recteur d'académie) qui mettront en œuvre sa politique et rendront compte de leur action.
La décentralisation consiste à confier des compétences à des collectivités autonomes, dotées de la personnalité morale (collectivités territoriales comme les communes, départements,
régions ou à des établissements publics). Le but étant d'associer les habitants à la gestion de leurs affaires, la décentralisation va de pair avec l'élection (au suffrage universel direct pour les conseillers
municipaux). Et si l'on veut que la décentralisation soit effective, les collectivités territoriales et leurs élus doivent pouvoir disposer des ressources nécessaires à l'exercice autonome de leurs compétences. Dans
la logique de l'État unitaire, il va de soi que le pouvoir conserve un pouvoir de contrôle des collectivités territoriales : les collectivités territoriales sont créées et supprimées par le gouvernement
central, qui peut aussi rétrécir ou élargir leurs pouvoirs à sa discrétion.
Bien que le pouvoir politique peut être délégué aux collectivités locales
par la loi, le gouvernement central demeure suprême, il peut abroger les actes de gouvernements décentralisés ou restreindre leurs pouvoirs.
Juridiquement, être souverain, c'est avoir la compétence de la compétence :
cela signifie en pratique que c'est celui qui définit qui a une compétence qui est souverain ; par conséquent, l'État reste unitaire s'il conserve le pouvoir de révoquer les compétences qu'il a transférées
(juridiquement parlant, même si politiquement parlant, ce ne serait pas possible).
La République de Solon
Pour Aristote, Solon se garde
d’abolir les institutions qui existent et universalise le suffrage parmi les citoyens: tous les citoyens ont accès aux jurys (les héliastes).
Il ajoute que, « Solon lui-même
n’a vraisemblablement attribué au peuple que le pouvoir strictement nécessaire, celui d’élire les magistrats et de vérifier leur gestion (car si le peuple ne possède même pas sur ce point un contrôle
absolu, il ne peut qu’être esclave et ennemi de la chose publique). »
Alors que l’écart entre les riches aristocrates et la classe populaire se creuse et qu'Athènes sombre dans une crise sociale,
toutes les classes sociales se tournent vers lui pour remédier à la situation qui pouvait déboucher sur la tyrannie. Elu archonte (594–593 av. J.-C.), on attend de lui qu'il remédie aux conflits dans la Cité.
Ainsi, il abolit
l'esclavage pour dettes, et affranchit ceux qui étaient tombés en servitude pour cette raison. Il fait une réduction de dettes privées et publiques, et affranchit les terres des hectémores
de redevances. Cependant, il ne fait pas de réforme agraire, il ne redistribue pas la propriété des terres, bien que les pauvres l'aient attendu.
Sur le plan politique, il met en place le tribunal du peuple, l'Héliée. Tous les citoyens ont accès aux jurys (héliastes) et chacun a le droit d'intervenir en justice contre quiconque
a enfreint les lois, affirmant ainsi la responsabilité collective des citoyens. Les jurys sont constitués par tirage au sort parmi les volontaires. Le tribunal est principalement une Cour d'appel et Aristote considère qu'il est
déjà le lieu du contrôle des magistrats par le peuple.
Le critère d'éligibilité est fondé sur la fortune produite (pas directement sur le capital), et non plus sur la naissance. Seuls
les plus riches, peuvent accéder aux magistratures. Par contre, toutes les classes ont accès à l'Assemblée du peuple (Ecclésia) et au tribunal de l'Hélié. L'élection des magistrats ayant lieu à
l'Assemblée du Peuple, l'on peut considérer que le suffrage est universalisé parmi les citoyens, et c'est un point important pour comprendre la genèse de la démocratie à Athènes.
Solon étend
le droit de défense et d'accusation à n'importe quel citoyen. Il écrit aussi un nouveau code de lois s'appliquant au droit privé, au droit criminel et à la procédure
légale. Il crée le Conseil
des 500 (Boulè) chargé de proposer les décrets et les lois à l'Assemblée du peuple (Ecclésia), et le Conseil de l'Aréopage (Sénat judiciaire) formé
de magistrats (ex-archontes). Il effectue ainsi des réformes constitutionnelles qui lui valent la réputation d'être avec Clisthène l'un des pères fondateurs de la République.
La République des Sages
Les 7 Sages de la Grèce - Solon d'Athènes
: « Rien de trop»
(Thalès de Milet « Ne te porte jamais caution. » - Chilon deSparte « Connais-toi toi-même. » - Pittacos de Mytilène « Reconnais l'occasion favorable. » -
Bias de Priène « Les plus nombreux sont
les méchants. » - Cléobule
de Lindos « La modération
est le plus grand bien. » - Périandre de Corinthe « Prudence en toute chose ».)
La Cité idéale acquiert sa souveraineté lorsque ses lois et son autorité sont acceptées et respectées par tous. Son organisation repose sur des règles et un modèle
équivalents pour tous. Chaque citoyen y tient un rôle unique déterminé et sa législation est véritablement la meilleure chaque fois qu’elle met au pouvoir les Sages de la Cité.
Chacun doit
y exercer les tâches qui lui correspondent en fonction de sa nature. Le talent naturel, selon Platon, reste associé au don d’apprendre et de retenir. Celui qui est doué à l’exercice de la pensée
domine les autres genres car sa pensée est connaissance. Ainsi le petit nombre dominé par la pensée doit guider le grand nombre.
La Cité idéale a nécessairement de bonnes lois et le respect de
ses lois permet « la sauvegarde de l’opinion créée par la loi, au moyen de l’éducation, concernant les choses mêmes qui sont à craindre et leur nature ».
Socrate explique
que la connaissance et l’opinion ont des capacités différentes : la connaissance s’établit sur ce qui est et définit la sagesse. A contrario l’opinion est un jugement qui est liée à l’appréciation
des choses sans les connaître en soi. Dès lors le Sage apparaît comme celui qui, détenant la connaissance, est apte à veiller sur les lois et à être le gardien de la Cité. Il est l’homme de la Cité
idéale.
Le Sage est également le mieux placé pour juger de ce qui rend vraiment heureux. En effet, « les raisonnements sont l’instrument par excellence du Sage ». Il est le seul
à connaître la satisfaction que peut apporter la contemplation de la vérité et, pour Platon, il a « désir de connaître et amour du savoir ou philosophie ».
L’activité
principale du Sage consiste à chercher le Vrai, le Beau, le Juste, donc des valeurs, des normes, des principes, des idéaux, par-delà les choses sensibles, cela avec une sagesse et dans une perception globales.
Les Sages
sont garants de la Cité idéale. Leur régime politique est celui dans lequel tous les citoyens peuvent accéder à la connaissance et toutes les classes à l’assemblée du peuple. Euripide ajoute
que, « sont compétents les gens qui fréquentent les gens compétents. »
Enfin selon Platon encore, le seul régime politique parfait est le gouvernement des meilleurs qui réunit
pouvoir et sagesse entre ses mains. Mais Socrate prévoit que, naturellement, cette « aristocratie » finit par se corrompre, se dégrader, perdre son unité et fait le lit de la propriété privée
et de la démocratie fondée sur la liberté et l’égalité.
Quant à savoir si la Cité idéale adviendra, Socrate conclue : « Il en
existe peut-être un modèle dans le ciel pour celui qui souhaite le contempler et, suivant cette contemplation, se donner à lui-même des fondations. Que cette Cité existe quelque part, ou qu’elle soit encore à venir,
cela ne fait d’ailleurs aucune différence, car celui-là ne réalise que ce qui appartient à cette Cité et à nulle autre. »
La Cité des hommes
Mais la Cité idéale n'est pas réalisée ;
se pose alors la question de savoir ce que doit faire le Sage dans les cités humaines existantes, alors que celles-ci, à ses yeux, sont les cités des ignorants. Le Sage peut-il être citoyen d'une Cité de non-sages ?
Selon Chrysippe, le Sage doit participer à la vie active, si rien n'y fait obstacle. L'idée des stoïciens semble être que, si les circonstances
sont favorables, le Sage peut contribuer à faire progresser la vie des citoyens vers l'idéal de la grande Cité juste. Mais, lorsque les circonstances sont défavorables, par exemple lorsqu'un tyran fait régner
l'injustice, ou que les citoyens ne sont pas disposés à agir droitement, le Sage aura recours à d'autres moyens, en dehors de la vie politique. L'otium est un tel
moyen, puisque le loisir du Sage est un loisir studieux par lequel il contribue à enseigner ses concitoyens en exposant le fruit de ses réflexions politiques. Les stoïciens conçoivent ainsi, conformément à leur conception
active de la pensée, qu'il n'y a pas d'activité intellectuelle qui ne soit action, et, dans ce cas, action politique.
Le Sage est, dans le domaine pratique, celui qui, selon Aristote,
agit prudemment, et dont l'action peut être considérée comme la norme de la sagesse. Cette prudence est la capacité de juger à propos, dans une situation donnée, de l'application de règles générales.
Ce n'est donc pas le concept abstrait de sagesse qui fait le Sage, c'est le Sage qui montre la sagesse par l'action.
Si Aristote privilégie l'étude des cas particuliers dans l'action pratique, il estime par ailleurs, avec
des philosophes comme Platon ou Héraclite, que le Sage se distingue par une connaissance d'un ordre particulier, qui touche à la question de l'essence même de la réalité. Sa capacité de jugement et d'action est solidaire
d'une théorie de la réalité, théorie d'ordre métaphysico-physique.
Le Sage s'inscrit d'abord, ontologiquement en quelque sorte, dans un ordre de réalités universelles ; les occupations
humaines, et, en particulier, la réalité de la Cité sont pour lui secondaires, dérivées, ou même étrangères : le Sage obéit en effet d'abord aux lois véritables, c'est-à-dire,
pour certains (cyniques, stoïciens) à la nature cosmique et humaine immanente, ou pour d'autres à la connaissance pure et théorique de la réalité (Platon, Aristote), et cette harmonie, cette conformité à
un ordre qui dépasse l'homme et lui dicte son devoir être, est la vertu.
De ce fait, le Sage est comme le représentant d'un ordre de réalités supérieures, ou plus parfaites ; mais, par son action, et parce
qu'il fait en acte ce qui est sage, il ne peut se considérer comme soumis à des normes communes qui ne dérivent pas de la raison ou de la connaissance, mais sont édictées pour satisfaire les intérêts des non-sages.
S'affranchir des lois humaines, qu'il s'agisse des lois de sa nature, ou des lois de la Cité (sortir de la caverne, briser l'hypocrisie sociale, enfreindre les interdits) peut être le commencement de la sagesse. Il apparaît ainsi que le
chemin de la sagesse commence par un choix d'ordre pratique, un choix de vie, choix par lequel on se décide à agir en philosophe, c'est-à-dire à suivre la loi que l'on se donne.
Le Sage législateur
Thomas d'Aquin, dans plusieurs de ses commentaires sur Aristote, reprenait ainsi cette conception
du Sage antique :
« Comme le Philosophe le dit, au début de la Métaphysique (982a17), il appartient au Sage d'ordonner. La raison en est que la sagesse est la perfection la plus puissante de la raison, dont
le propre est de connaître l'ordre. En effet, même si les puissances sensitives connaissent les choses de manière absolue, cependant, connaître l'ordre d'une chose en regard d'une autre appartient à la seule intelligence
ou raison. Or on trouve deux ordres entre les choses : il y en a un entre les parties d'un tout ou d'une multitude, à la manière dont les parties d'une maison sont ordonnées entre elles ; il y a ensuite l'ordre que des choses
entretiennent avec leur fin. Et cet ordre-ci est plus important que le premier. Car, comme le Philosophe le dit, au onzième livre de la Métaphysique (1075a13), l'ordre entre les parties de l'armée a pour cause celui qu'entretient l'ensemble
de l'armée avec son chef. »
(Commentaires sur l’Éthique à Nicomaque)
Le Sage connaît la finalité des choses ; en conséquence, il sait également les ordonner selon
la place qui leur revient naturellement. Ainsi, dans le Sage, se lient l'amour de la science des choses et des hommes et l'amour de la vertu, si bien que le rôle nécessaire du Sage au contact de la nature de l'homme est celui de quelqu'un qui
façonne :
« Quelle place le philosophe tiendra-t-il dans la Cité ? Ce sera celle d'un sculpteur d'homme. » (Simplicius)
Mais, pour d'autres philosophes, comme les Cyniques, ce statut du Sage se traduit par une pratique radicale qui procède toutefois de la même idée : le Sage est au-delà
ou en deçà des conditions de vie humaines conventionnelles. Le Sage n'est pas concerné par les lois humaines, mais suit et adhère pleinement à celles de la nature humaine et cosmique, dans la mesure où l'homme est
un fragment du tout, de la nature.
Ce rejet des normes sociales, du pouvoir, des honneurs et des plaisirs, semble s'expliquer pour Antisthène de la manière suivante : le roi Cyrus lui demandait quelle était
la science la plus essentielle : "Désapprendre le mal", lui répondit-il.
Ainsi le cynique est-il en lutte contre les perversités humaines qu'il sent en lui, perversités qu'il voit, par exemple, dans l'éducation
et la culture générale qu'il rejette comme fin ; il fait effort, comme Hercule, pour se surmonter et se réconcilier avec lui-même dans la sagesse ; on lui demandait quel résultat il avait tiré de la philosophie :
"Elle m'a rendu capable d'avoir commerce avec moi-même."
Ainsi le mal est-il en l'homme : les passions l'entraînent à des actes qu'il juge après coup répréhensibles. L'homme malade ne se maîtrise
pas, et cet état le rend malheureux. Fait-il effort pour devenir son maître, il ressent encore "un vague à l'âme", un malaise indéfinissable, comme l'ami de Sénèque l'en informe.
Le Sage apparaît
alors comme l'homme qui s'est guéri des maux de la condition humaine. C'est cette vertu curative de la sagesse qui sera mise en avant chez les stoïciens : guérir la nature humaine, en la réformant.
Depuis
les premiers Sages (comme Thalès) jusqu'aux stoïciens de l'époque impériale, en passant par Socrate et les Cyniques, la figure du Sage s'est donc profondément transformée : elle a d'abord exprimé une sagesse
commune, sans doute bien établie, sur l'homme bon, juste, et il ne semble pas qu'elle ait servi principalement pour réformer l'humanité (bien que les aphorismes des Sept Sages soient également des conseils) ; elle
est devenue ensuite la figure idéale de l'homme délivré du mal qui est en lui, ce qui suppose un franc pessimisme moral à l'égard de la nature humaine, ce qui n'apparaît guère de ce point de
vue à l'origine de la pensée, si ce n'est chez Anaximandre.
Deux grands types de remède se distinguent : ceux qui placent la finalité de la guérison
dans le repos et l'apaisement ; ceux qui envisagent de vaincre les perversités humaines, et de transfigurer l'homme de cette manière.
Le Sage épicurien
Épicure s'est proposé de remédier aux maladies de l'âme humaine qu'il
ramène à la crainte, qui provient principalement de jugements faux sur les choses, et de l'ignorance de la nature. Connaître la nature, c'est se donner les moyens de vaincre les terreurs superstitieuses qui tourmentent l'humanité.
C'est aussi savoir juger des vrais plaisirs, éviter les souffrances et se satisfaire de ce dont notre nature a besoin.
Le quadruple remède épicurien se résume ainsi :
- les dieux ne sont pas à craindre ;
- la mort n'est pas à craindre ;
- la douleur est facile à supprimer ;
- le bonheur est facile à atteindre.
De cette manière, Épicure s'efforce de déterminer un modèle
de vie qui soit accessible à tous. Le Sage épicurien maîtrise ses désirs et la fortune :
D’après toi, quel homme surpasse en force celui qui sur les dieux nourrit des convictions conformes
à leurs lois ? Qui face à la mort est désormais sans crainte ? Qui a percé à jour le but de la nature, en discernant à la fois comme il est aisé d’obtenir et d’atteindre le « summum »
des biens, et comme celui des maux est bref en durée ou en intensité ; s’amusant de ce que certains mettent en scène comme la maîtresse de tous les événements — les uns advenant certes par nécessité,
mais d’autres par hasard, d’autres encore par notre initiative —, parce qu’il voit bien que la nécessité n’a de comptes à rendre à personne, que le hasard est versatile, mais que ce qui vient par notre
initiative est sans maître, et que c’est chose naturelle si le blâme et son contraire la suivent de près (en ce sens, mieux vaudrait consentir à souscrire au mythe concernant les dieux, que de s’asservir aux lois du destin
des physiciens naturalistes : la première option laisse entrevoir un espoir, par des prières, de fléchir les dieux en les honorant, tandis que l’autre affiche une nécessité inflexible).
Le résultat
du remède épicurien est de faire de l'homme un dieu parmi les hommes : "tu vivras parmi les hommes comme un dieu. L’homme qui vit au milieu de biens immortels n’a plus, en effet, rien de commun avec les mortels".
L'épicurisme conçoit le bonheur dans le repos ; à l'image de sa conception des dieux, l'homme sage est retiré du monde, il vit dans la quiétude, entouré d'amis.
Le Sage est stoïcien
L'ensemble de caractéristiques qui ont été exposées plus haut vont se trouver rassemblées et approfondies
dans ce que l'on considère comme le premier système philosophique, le stoïcisme. Dans ce dernier, on distingue nettement les influences de Héraclite, d'Aristote, des cyniques, et la synthèse
de ces influences va produire une pensée entièrement tournée vers l'éthique, et la réalisation de l'homme sage. Cette pensée est donc assez représentative de l'idée que
l'on se faisait du Sage dans l'Antiquité.
Le stoïcisme est la figure la plus radicale du Sage, il est le prolongement du cynisme en même temps que sa reformulation ; elle est radicale en ce sens qu'elle
n'est pas seulement une subversion des valeurs jugées plus ou moins hypocrites de la société (comme le cynisme semble l'être), mais un essai d'accomplir en tout la totalité de la nature humaine, et de porter ainsi la question
du sage à ses limites extrêmes ; de cette manière, le Sage se trouve par delà l'humain trop humain (les passions essentiellement) par la cure sévère qu'il a suivi pour réformer son âme et rétablir
en lui l'ordre naturel que l'ignorance, la faiblesse et les préjugés de l'éducation pervertissent.
À l'instar du Lachès
que Platon nous a représenté, les stoïciens (et les philosophes antiques en général), se méfient des discours
théoriques qui ne se traduisent pas en actes et les méprisent ; un discours sur le Sage n'a de valeur que s'il trouve à être réalisé. Plutarque
nous résume la conception antique sur ce sujet :
« Je juge d'abord que l'accord des pensées doit apparaître dans la conduite de la vie. Autant et plus que l'orateur, selon Eschyne, doit dire la même chose
que la loi, la vie du philosophe doit être d'accord avec son discours ; car le discours du philosophe est une loi choisie par lui et qui lui est propre, si l'on pense que la philosophie n'est pas un jeu et un bavardage en vue de la réputation,
mais qu'elle est une œuvre digne du plus grand sérieux. »
On ne peut donc parler du Sage, sans parler de ce qu'il fait, puisque le Sage agit comme Sage, et non seulement comme individu se représentant
ce qu'est un Sage (le Sage peut même être inconscient du fait qu'il est un Sage). On peut toutefois, de manière théorique, faire une description du Sage stoïcien dans son rapport au cosmos et à la nature, énoncer
les difficultés de la possibilité d'être du Sage, et faire le portrait des non-sages. Ce sont là des lieux de la pensée stoïcienne.
Dans le stoïcisme, l'image du Sage est fréquemment évoquée
comme norme ; en tant que telle, elle trouve sa formulation la plus générale comme question : Que ferait le Sage dans cette situation ? C'est la question que doit se poser celui qui veut progresser vers la sagesse lorsqu'il se
trouve dans l'incertitude. Sénèque approuvait ainsi le précepte épicurien : "Agis comme si Épicure te regardait."
Il reste alors à décrire ce qu'est le Sage en action. Or,
c'est à une psychologie du Sage en action que se livrent Sénèque et tous les penseurs qui s'attachent non à théoriser, mais à montrer en pratique les principes suivis par le Sage. Le Sage n'est pas une théorie,
ni une conscience de ce qu'est être sage ; le Sage, ce sont les principes réalisés, c'est-à-dire l'action et les jugements qui précèdent l'action. Dans la perspective des paradoxes du sage, on
peut poser que le stoïcisme est une sagesse de l'action, que ces deux notions sont bien près de s'équivaloir, et qu'il n'y a pas d'action qui ne soit d'un Sage : seul
le Sage agit, puisque les ignorants se laissent gouverner par les passions.
En accord avec la nature, le Sage stoïcien s'illustre par son action droite et conforme en
toutes circonstances à ses principes. Le stoïcisme reprend la conception socratique du mal, en affirmant l'immunité du Sage en ce qui concerne le mal.
L’injure a pour but de faire du mal à quelqu’un :
or la sagesse ne laisse point place au mal. Il n’est de mal pour elle que la honte, laquelle n’a point accès où habitent déjà l’honneur et la vertu : l’injure ne va donc point jusqu’au sage. Car
si elle est la souffrance d’un mal, dès que le Sage n’en souffre aucun, aucune injure ne peut le toucher.
Le Sage stoïcien est un homme exceptionnel ; c'est pourquoi, la politique qui lui convient ne peut qu'être exceptionnelle.
Les Stoïciens disent encore qu’il y a trois bonnes affections : la joie, la prudence, la volonté ; la joie est le contraire du plaisir, car elle est un désir raisonné ; la prudence est le contraire
de la crainte, car elle est une fuite raisonnée, ainsi le Sage n’a jamais peur, mais il est toujours sur ses gardes. Enfin la volonté est le contraire du désir, en ce qu’elle est un souhait raisonné. Tout comme les principales
passions, les principales bonnes affections comportent des espèces : ainsi la volonté comprend la bienveillance, le calme, la douceur et l’affection. La prudence comprend : la pudeur, la chasteté ; enfin la joie comprend
la gaieté, l’enjouement, la bonne humeur.
Le destin du Sage
Tous
les penseurs antiques sont d'accord pour affirmer que l'homme doit suivre la nature, et que la finalité de l'action humaine est le bonheur.
Les limites de la nature humaine sont l'occasion d'affirmer la puissance de l'homme, quand il parvient
à surmonter sa condition misérable ; cette conception est ainsi l'exact opposé de toutes les conceptions religieuses et philosophiques qui font de la finitude (mort, misère de l'homme et limites de ses capacités) l'expression de sa déchéance existentielle ou de ses péchés.
Mais c'est une voie difficile, où le Sage affronte la Fortune : « Les stoïciens, prenant une voie plus digne de l’homme, ne s’inquiètent point qu’elle paraisse riante à ceux qui s’y engagent :
ils veulent au plus tôt nous tirer de péril et nous conduire à ce haut sommet tellement hors de toute atteinte qu’il domine la Fortune elle-même. »
Le Sage est ainsi au-dessus des contingences, de ce qui
lui arrive, et l'adversité, loin de l'abattre, l'affermit dans sa vertu ; ce qui ne le tue pas le rend plus fort :
« Pourquoi s’étonner que l’homme de bien soit ébranlé
pour être affermi ? Il n’est d’arbre solide et vigoureux que celui qui souffrit longtemps le choc de l’aquilon. Les assauts même qu’il essuie rendent sa fibre plus compacte, sa racine plus sûre et plus ferme.
Il est fragile s’il a crû dans un vallon aimé du soleil. Concluons que l’intérêt des gens de bien, s’ils veulent que la crainte leur devienne étrangère, exige qu’ils marchent habituellement au
milieu des terreurs de la vie et se résignent à ces accidents qui ne sont des maux que pour qui les supporte mal. »
Ce qui est le destin du Sage qu'il consent
à suivre sans hésiter :
« Quel est le devoir d’une âme vertueuse ? De s’abandonner au destin. C’est une grande consolation d’être emporté avec l’univers. Quelle
que soit la loi qui nous impose cette vie et cette mort, elle est la même nécessité qui lie aussi les dieux : une marche irrévocable entraîne les choses humaines comme les choses divines. L’auteur et le moteur de
l’univers a écrit la loi des destins, mais il y est soumis : il obéit toujours, il a ordonné une seule fois. »
Dès l'Antiquité, cette nature quasi-divine du Sage définie
par les stoïciens fut jugée impossible et paradoxale. On parle ainsi des paradoxes de la sagesse, tant la formulation de ce qu'est un Sage dans le stoïcisme semble dépasser ce qui est humainement possible. Le Sage est
en effet seul roi, seul savant, seul habile dans les arts. Cette conception, qui peut apparaître surréaliste pour un moderne, s'explique par une conception de la connaissance
et de la morale qui part des dispositions de la personne qui sait et qui pratique réellement son savoir éthique. Ainsi le Sage n'est-il pas celui
qui sait tout, comme la formulation des paradoxes pourrait le laisser croire, mais celui qui ne donne son adhésion qu'à ce qui est vrai et n'agit que d'après ce qui dépend réellement de lui. C'est pourquoi, on ne peut devenir
Sage sans étudier la logique.
Le Sage ne se confond pas avec la masse des hommes. Il n'est pas soumis aux mêmes lois qu'eux ; l'ordre de la sagesse est supérieure aux devoirs communs des hommes, car le Sage
suit la vertu, et non seulement les fonctions propres inhérentes aux hommes.
Si rien ne peut le toucher, c'est parce qu'il juge droitement sur la valeur des choses, il est donné au Sage seul de savoir apprécier chaque chose à
sa juste valeur, écartant biens et maux comme indifférents, et ne jugeant de valeur que ce qui dépend de lui :
Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d’autres non. De nous,
dépendent la pensée, l’impulsion, le désir, l’aversion, bref, tout ce en quoi c’est nous qui agissons ; ne dépendent pas de nous le corps, l’argent, la réputation, les charges publiques, tout
ce en quoi ce n’est pas nous qui agissons.
Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacles ni entraves ; ce qui n’en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est
étranger.
La
mort ne trouble pas le Sage
Le Sage est ainsi seul libre, parce qu'il possède ce qui dépend de lui, et ne désire pas ce qui ne dépend pas de lui. Et c'est l'adhésion à la nature qui est le bien
fondamental, la vertu véritable dont la possession rend invincible :
« En face des appareils les plus terribles son œil est fixe, intrépide ; son visage ne change nullement, qu’il ait de dures épreuves
ou des succès en perspective. Donc le sage ne perdra rien dont il puisse ressentir la perte. Il a en effet pour seule possession la vertu, dont on ne l’expulsera jamais ; de tout le reste il n’use qu’à titre précaire :
or quel homme est touché de perdre ce qui n’est pas à lui ? »
Le Sage vit
son temps
Le Sage se possède par sa vertu ; et par cet empire sur les réalités qui seules ont de la valeur, le sage est le seul riche : "Reprends possession de toi-même."
Les ignorants en effet ne se possèdent pas, mais dilapident ce qui en eux est de valeur ; le reste est fausse richesse.
Sénèque situe cette prise de possession nécessaire à l'accès au statut de
Sage, dans le temps : "Montre-moi un homme qui mette au temps le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail ! Car c’est notre erreur de ne voir la mort que devant nous : en
grande partie déjà on l’a laissée derrière ; tout l’espace franchi est à elle."
Le Sage est maître du temps. Nous ne manquons pas de temps pour vivre, nous ne vivons pas notre temps :
l'ignorant vit à côté de sa vie, en subissant le temps des autres. Le Sage se revendique, et conquiert ainsi sa liberté. Cet état de liberté lui permet de vivre chaque instant comme un accomplissement de sa nature,
et de mourir sans regret : il ne peut plus en effet rien ajouter à la perfection de son être, et il ne désire plus rien qui soit étranger à lui-même.
Le Sage contemporain
C'est un lieu commun de la pensée contemporaine occidentale, que les valeurs tant morales,
qu'esthétiques et cognitives, ont subi une forte dévalorisation, conduisant au relativisme,
au scepticisme, et, parfois, au nihilisme.
Le Sage ne semble donc pas pouvoir
être un modèle de vie dans des sociétés,
où, selon l'expression vulgaire, les "repères se sont perdus". D'où le Sage tirerait-il en effet sa légitimité ? Ni de la morale, ni d'une conception cosmique de l'existence
humaine. Cette dernière est à présent l'affaire des scientifiques, et elle n'est plus une préoccupation majeure des philosophes.
Ainsi ne peut-il
plus y avoir de Sage comme microcosme, représentant d'un ordre de la nature dans
lequel l'homme trouve sa place. Cette théorie est par ailleurs jugée contraire à la liberté
individuelle dans les pays où les hiérarchies sociales et les religions ont perdu de
leur influence. Il en va de même de la morale ; au nom de quoi, demandera-t-on, y aurait-il un Sage qui dirait ce qui est juste et bon ?
Chacun est libre de se déterminer selon sa conscience, et le Sage serait une intolérable contrainte à la volonté
moderne d'autonomie.
Pourtant, c'est aussi un lieu
commun de dire que la philosophie fait l'objet aujourd'hui d'une demande toujours plus forte. Ceci n'est pas nouveau. Quand Sénèque écrit sur
la providence ou sur le Sage, il répond à une personne qui sent cette perte de repères qui est également une source d'inquiétude pour les hommes occidentaux des sociétés contemporaines. Le Sage n'est pas ainsi obsolète, mais peut toujours conserver sa valeur d'idéal
de vie juste et bonne et de modèle.
Si nous imaginons comment vivrait un Sage aujourd'hui, celui-ci serait probablement un clochard ou un vagabond, ou un homme vivant modestement et proche de la nature (modèle de Diogène) ; ou un maître de morale interpelant ses concitoyens, ou un satiriste (modèle de Socrate,
de Cratès) ; ou un défenseur de la citoyenneté universelle stigmatisant les cités particulières (modèle
du stoïcisme). Bien d'autres exemples sont possibles, qui montrent que les figures du Sage antique peuvent être transposées presque sans changement dans le monde
d'aujourd'hui.
Le Sage Chercheur
L'apparition d'un métier spécifique de chercheur
s'inscrit dans le cadre de la spécialisation des tâches au sein de nos sociétés. Auparavant, les inventions
et les connaissances étaient le fruit d'expérimentations de tout un chacun au quotidien. Avec Francis
Bacon, au XVIIe siècle, l'Occident commence à prendre conscience de l’intérêt économique
et politique d'une recherche organisée. La fondation d'académies des sciences atteste de l'intérêt
naissant des États pour les travaux des chercheurs et leur apporte un cadre d'échange et une certaine reconnaissance sociale. Cette évolution de la place sociale
des chercheurs est indissociable de l'évolution de la nature même du travail de recherche, et en particulier l'élaboration progressive d'une
méthode scientifique, à partir de la révolution
copernicienne.
Marie Curie, chercheuse du XXe siècle
L'exercice du métier de chercheur repose sur des exigences d'innovation, d'imagination mais aussi de réflexion, de savoir-faire, de connaissances, et de capacités techniques. Ces dernières conditions ne se développent
qu'avec l'expérience personnelle et la confrontation avec les questions soulevées par la recherche. La charte européenne
du chercheur définit des principes de base d'exercice de ce métier.
Le Sage Intellectuel
Plusieurs conceptions du rôle de l'intellectuel dans la société peuvent être évoquées.
En 1895, Octave
Mirbeau définissait ainsi la mission de l'intellectuel : « Aujourd’hui l’action doit se réfugier dans le livre. C’est dans le livre seul que, dégagée des contingences
malsaines et multiples qui l’annihilent et l’étouffent, elle peut trouver le terrain propre à la germination des idées qu’elle sème. Les idées demeurent et pullulent : semées, elles germent ;
germées, elles fleurissent. Et l’humanité vient les cueillir, ces fleurs, pour en faire les gerbes de joie de son futur affranchissement. »
Raymond
Aron, dans L'Opium des intellectuels (1955), pose cette question du rôle du savant dans la cité, et concernant les grands débats du moment. Pour Aron, l'intellectuel est un « créateur
d'idées » et doit être un « spectateur engagé ». À cette conception s'oppose celle du dreyfusard Julien
Benda. Dans un essai intitulé La Trahison des clercs (1927), il déplorait le fait que les intellectuels, depuis la guerre, aient cessé
de jouer leur rôle de gardiens des valeurs « cléricales » universelles, celles des dreyfusards (la Vérité,
la Justice et la Raison), et les délaissent au profit du réalisme politique, avec tout ce que cette expression
comporte de concessions, de compromis, voire de compromissions. La référence aux « clercs » (que la tonsure distinguait des laïcs) souligne cette fonction quasi-religieuse qu'il assigne
aux intellectuels. L'attitude du clerc est celle de la conscience critique (plutôt que de l'engagement stricto sensu).
Jean-Paul Sartre, définira
l'intellectuel comme « quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». C'est celui à qui, selon la formule de Diderot
empruntée à Térence, rien de ce qui est humain n'est étranger, qui prend conscience de sa responsabilité individuelle dans une situation donnée,
et qui, refusant d'être complice, par son silence, des injustices ou des atrocités qui se perpètrent, en France même ou ailleurs dans le monde (pensons au rôle de Sartre dans le Tribunal Bertrand
Russell érigé pour juger les crimes de guerre au Vietnam), utilise sa notoriété pour se faire entendre sur des questions qui ne relèvent pas strictement de son domaine de compétence, mais où l'influence
qu'il exerce et le prestige, national ou international, dont il bénéficie peuvent se révéler efficaces. L'intellectuel, pour Sartre, est forcément « engagé » pour
la cause de la justice, et donc en rupture avec toutes les institutions jugées oppressives.
Pour Albert Camus, soixante ans plus tard, l'écrivain « ne
peut se mettre au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la subissent » : « Notre seule justification, s’il en est une, est de parler, dans la mesure
de nos moyens, pour ceux qui ne peuvent le faire. » Mais, ajoute-t-il, il ne faudrait pas pour autant « attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales. La vérité est mystérieuse,
fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. »
Pour le sociologue Laurent Muchielli, directeur de recherches au CNRS, « le rôle des intellectuels est de rompre avec les registres événementiel et émotionnel, qu’ils soient consensuels ou conflictuels, pour tenter
d’apporter quelques éléments de réponse au débat collectif ».
Le Sage Economiste
Les économistes jouent un rôle d’expertise pour les centres de décision (organisations) et pour les dirigeants politiques (État, collectivités
territoriales). Ils recommandent la mise en œuvre de politiques économiques ou réformes économiques pour améliorer le fonctionnement de l’économie, l’adapter aux changements, atteindre des objectifs de production,
distribution et de Répartition en termes
de prospérité,de bien-être collectif, de solidarité, d'équité et de Développement durable.
Les économistes ont souvent un domaine de spécialisation ; cela peut être l’étude de l'intelligence économique, de la veille
économique, du marché du travail (Pierre Cahuc, Francis Kramarz, Olivier Blanchard, etc.), l’étude de la politique monétaire, des marchés financiers (Michel Aglietta, etc.), l’économie géographique, l’économie des institutions, l’économie
de la santé, etc. (voir Liste des branches de l'économie).
Les hommes politiques font appel à l’analyse d'économistes avant de mettre en place des mesures de politique
économique. Par ailleurs, de nombreux hommes politiques sont diplômés en économie.
Différents courants de pensée économique existent de nos jours. Après l'effondrement du communisme, les conceptions
principales ( en dehors de courants relativement marginaux ), oscillent entre les tenants du libéralisme économique partisans
du système économique capitaliste de libre-entreprise et les tenants de l'économie
sociale de marché soucieux de régulations plus ou moins fortes et de la mise en place de politiques économiques permettant de gommer certains défauts engendrés par le fonctionnement spontané des marchés.
Cela dit, les idées en science économique sont en perpétuelle évolution et les recommandations de politique économique changent graduellement dans le temps et dans l'espace : à l'intérieur ou en marge des courants économiques
majeurs de nouvelles tendances pointent…
Le Sage Homme d'Etat
Le qualificatif d'homme d'Etat a un aspect mélioratif, et vise à souligner la capacité du personnage d'État à s'élever
au-dessus des divisions partisanes pour rechercher le seul bien commun, ainsi que l'acuité de sa conscience
de ses propres responsabilités. Évoquant
le souvenir de Charles de Gaulle, René Rémond explique
ainsi à son propos : « lui aussi a oscillé entre l'aspiration à l'unanimité nationale et l'obligation de devenir le chef d'une fraction contre une autre. Seuls, sans doute, les politiques qui
ont l'étoffe d'un homme d'État connaissent ce partage. Au politicien tout est simple, et il ne se pose pas tant de question. »
Selon Aristote, « le premier devoir de l'homme d'État est de connaître la constitution qui doit généralement passer pour la meilleure
que la plupart des cités puissent recevoir. »
Sa priorité, pour construire la Cité idéale, repose également sur deux responsabilités principales :
La première
est de refonder un projet de société qui permette l'adhésion du plus grand nombre. La construction de ce projet repose sur le pragmatisme et l'absence de tout esprit de système. Cela
ne se résume pas seulement à l'annonce de quelques mesures symboliques mais consiste à redonner à la politique sa primauté aux valeurs fondamentales de la Cité : la justice, le courage, la volonté, le travail, le
mérite, la réussite, l'autorité, la souveraineté, la responsabilité, la laïcité, la liberté, l'humanité. Autant
de piliers de la société civile oubliés par la classe politique qui n'entend plus les habitants de la Cité. La classe politique doit se renouveler, produire des idées nouvelles et comprendre les aspirations
profondes des citoyens qui ont besoin qu'on leur parle des valeurs sans lesquelles une Cité disparaît.
La deuxième responsabilité de l'homme d'Etat est de mettre en oeuvre son projet. Pour cela, il doit
réunir deux conditions : empêcher la guerre et renoncer à tout esprit de revanche. Comme l'écrivait Francis Bacon : "En prenant sa revanche, un homme devient égal à son ennemi mais en s'abstenant de la prendre,
il lui devient supérieur."
Un projet républicain : la République sociale
En règle générale, dans les débats de philosophie politique contemporaine, la philosophie républicaine s'oppose au libéralisme politique. En effet, le libéralisme politique défend une philosophie du sujet rationnel, "désengagé" de ses appartenances héritées,
et demande que ce sujet soit libre, c'est-à-dire, pour le libéralisme, qu'il ne subisse pas d'interférence quand il use de sa raison pour faire des choix n'engageant que son mode de vie. Le rôle du droit et de l'État est de
préserver cette liberté, considérant qu'il existe un espace individuel sur lequel l'espace social ne doit avoir aucun pouvoir.
La République sociale ou Républicanisme comprend le sujet
et sa liberté différemment. Il fait une place le plus souvent aux caractéristiques sociales des individus (Charles Taylor, Philip Pettit, John Maynor), comme son statut
professionnel, son genre, sa culture - mais pas toujours (Hannah Arendt). Puis il pose la non-domination comme définition du principe de liberté.
Pour lui, le citoyen doit jouir d'un statut social qui lui assure une indépendance à l'égard d'autrui : « Pour faire un républicain, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il
soit, un enfant, un adolescent, une jeune fille ; il faut prendre l'homme le plus inculte, le travailleur le plus accablé par l'excès de travail, et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance
à personne. » (Ferdinand Buisson, 1887).
Elle reconnaît un rôle essentiel à l'État comme garant de la non-domination. Elle pose, en effet, qu'une règle sociale peut
être génératrice de liberté (liberté de réunion et liberté
de la presse acquises grâce à la loi de 1881). En ce sens, elle
distingue entre les interférences, ce que le libéralisme ne fait pas : il y a des interférences légitimes (comme celles de la loi, lorsque celle-ci vise à assurer la non-domination), et des interférences arbitraires,
qui doivent être combattues parce qu'elles sont arbitraires, et non parce qu'elles interfèrent. Elle définit un état contrôlé par ses citoyens et où la loi émane d'eux, à travers
leurs représentants. L'électeur a pour « devoir » d'essayer de sélectionner les candidats aux élections en fonction, non pas de son intérêt personnel, mais en fonction de leurs aptitudes à
défendre le bien commun. Les gouvernants, quant à eux, dans cette philosophie, doivent prendre des décisions visant le bien commun, l'intérêt général. S'il y a divergence sur ce bien commun,
il faut alors en débattre. Ce courant est donc empreint d'exigences éthiques.
Dans le débat politique contemporain, le philosophe Rawls, penseur majeur d'un
certain libéralisme politique, s'est rapproché d'une certaine voie républicaine, qu'il appelle le « républicanisme politique », et qui insiste moins sur les valeurs politiques communes pour
préférer constituer la non-domination comme la seule « chose publique » (res publica), le seul "bien commun" (chez Pettit en particulier).
Sa théorie de la justice se rapproche des valeurs républicaines.
Il est évident qu’un lien étroit unit le républicanisme contemporain, sous toutes ses formes, et les idéaux et valeurs de la démocratie
participative et délibérative. Il est tout aussi incontestable que l’un des thèmes classiques du républicanisme, que l’on retrouve intact dans ses revendications actuelles, concerne l’opposition au populisme et
à la tyrannie en tant que domination exercée par une majorité dénuée de fondements suffisants. Il est vrai que des républicanistes comme Skinner ou Pettit ont opté pour un type de républicanisme
« néo-romain », où la participation politique démocratique ne peut être appréciée que comme moyen destiné à protéger la valeur qu’ils considèrent centrale :
la liberté comme non-domination. En cela, ils s'opposent à d’autres républicanistes, dits « néo-aristotéliciens », pour qui la participation citoyenne
est dotée d’une valeur intrinsèque et non instrumentale qui contribue à définir l’idéal d’excellence humaine. Et même pour ce républicanisme, que nous pourrions taxer de perfectionniste, il
est fondamental de trouver un schéma institutionnel qui limite le risque de tyrannie et qui freine la menace constante du populisme plébiscitaire.
Certes, tandis que certains républicanistes voient la démocratie et la participation
démocratique comme un instrument pour atteindre de plus grandes marges de liberté, elle devient pour d’autres une fin en elle-même. Mais cette différence, plutôt d’ordre théorique, n’a pas de répercussion
sur la façon dont chacun de ces républicanismes peut concevoir ou revendiquer les idéaux de démocratie participative.
Le projet Civicus
World Alliance for Citizen Participation: "gouverner sans gouvernement"
Les initiatives citoyennes sont fort anciennes mais elles deviennent plus que jamais nécessaires car l’Etat n’est plus le seul acteur. Certes il demeure, comme fondateur
du droit international, un acteur " fondamental ", et reste le principal producteur de normes. Mais son territoire n’est plus le seul espace normatif
Dans le contexte actuel
de globalisation des flux, des crimes et des risques environnementaux, sanitaires ou financiers, les Etats sont peu à peu marginalisés et de plus en plus impuissants.
Le
modèle de référence, le modèle souverainiste, ainsi déstabilisé, se révèle mal adapté à la mondialisation. Le dispositif qui se met en place n’est ni purement national, ni purement
international, mais " internationalisé ", c’est-à-dire simultanément national, inter et supranational. Sa régulation appellerait une organisation complexe qui puisse fonctionner à ces trois niveaux et inclure l’ensemble
des acteurs
Le modèle universaliste, substituant (ou ajoutant) l’Etat Monde à l’Etat nation, n’est ni faisable, en raison
de la résistance des grandes puissances, ni souhaitable, s’il conduit celles-ci à pratiquer une sorte d’impérialisme à l’échelle mondiale. Quant au modèle ultra-libéral (les marchés
autorégulés), il privilégie les intérêts économiques privés sans prendre en considération le bien commun. Ni l’universalisme ni l’ultra-libéralisme, ne permettent d’ailleurs
de relever l’autre paradoxe d’une mondialisation qui se veut universaliste mais reconnaît la diversité des cultures comme « patrimoine commun de l’humanité» (Déclaration puis Convention Unesco, 2001,
2005).
Nous sommes donc en quête d’un modèle alternatif, à la fois universel et pluriel, régulé et autorégulé, qui supposerait
une véritable innovation démocratique. Si les crises paraissent d’abord conduire à une impasse et à un vide dans la mesure où elles reflètent l’absence de modèle théorique sur lequel s’appuyer
pour organiser les pouvoirs, elles ouvrent aussi une voie pour en sortir. Révélant la désarticulation des pouvoirs au sein des institutions nationales et leur recomposition par fragments au sein des institutions supranationales, elles
suggèrent, de façon encore implicite, la montée en puissance des pouvoirs non institués qui participent au rééquilibrage et à la refondation des pouvoirs en contribuant à « ordonner
le pluralisme » (en un modèle que l’on peut nommer « pluralisme ordonné »)
Pour apprendre à gouverner sans gouvernement,
il faut en effet inventer de nouveaux instruments juridiques qui permettent de repenser les fonctions traditionnelles. Combinés à une judiciarisation croissante, les acteurs civiques peuvent réussir à " arracher " le monopole des
fonctions législatives et juridictionnelles aux Etats et à mettre en place des processus de coordination pour compenser leur dispersion à différents niveaux. Leur montée en puissance, qui a parfois permis d’inverser
la hiérarchie savants/sachants, ou même gouvernants/gouvernés, laisse donc entrevoir la possibilité d’un rééquilibrage.
La terminologie
utilisée à propos des acteurs de la gouvernance mondiale invite à distinguer les acteurs publics (Etats et organisations interétatiques) des acteurs privés, non-étatiques. Parfois désignés
dans le langage courant comme "la société civile", ces derniers regroupent en réalité une grande variété d’acteurs, individuels et collectifs, dont les intérêts sont souvent divergents. Principalement
trois catégories :
les acteurs économiques que sont les entreprises transnationales ont des pouvoirs considérables en raison de leur budget
et de leur organisation. Ils concurrencent désormais les Etats et élaborent leurs propres normes dont ils organisent le contrôle par autorégulation.
les
acteurs scientifiques, experts du climat ou de la santé, économistes, juristes, (…), jouent un rôle souvent déterminant dans la gouvernance mondiale, à l’instar des économistes auprès de
la Banque mondiale ou des climatologues du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) en interface avec les décideurs politiques sur le climat.
Enfin les acteurs civiques, qui renvoient aux notions de citoyen et d’initiative citoyenne, peuvent être entendus dans le sens politique d’acteurs qui endossant le rôle de contre-pouvoirs spontanés
ou de corps intermédiaires plus organisés. Leur pouvoir a été conquis de haute lutte, aucune institution n’étant spontanément disposée à leur reconnaître un tel rôle.
La démocratie participative peut se définir par comparaison avec la forme représentative qui repose sur l’élection de représentants des citoyens, mais
elle exclut la participation des citoyens dans l’intervalle entre chaque élection. Il est donc pertinent de concevoir des processus, comme les conférences de consensus, qui associent en permanence les citoyens aux décisions
importantes. Le secteur de l’environnement est particulièrement inventif en matière de participation citoyenne. C’est d’ailleurs pour faire reconnaître l’écocide comme crime contre l’environnement
que la première initiative citoyenne a été lancée à partir du nouveau dispositif créé en Europe par le Traité de Lisbonne en 2007.
Auparavant, l’Union Européenne n’accordait aux citoyens européens qu’un droit de pétition. En instaurant un véritable droit d’initiative populaire, le traité n’institue
pas un pouvoir législatif direct mais il permet à un groupe de citoyens de saisir la Commission européenne d’une proposition de loi. L’usage du droit d’initiative populaire par les ressortissants européens sera
source d’enseignements pour imaginer à terme un mécanisme équivalent à l’échelle mondiale. Certes un tel dispositif n’est pas directement transposable tel quel, non seulement parce que la démocratie
est loin d’être généralisée à tous les Etats, mais aussi parce que l’espace mondial n’est organisé que de façon fragmentaire et incomplète. Néanmoins, un droit d’initiative
populaire pourrait être conçu, précisément dans des secteurs particulièrement sensibles comme la santé ou l’environnement, par le relais des organisations internationales comme l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) ou la future Organisation mondiale de l’environnement (OME).
Les initiatives citoyennes sont souvent associées à des actions de militants
et d’activistes. Il faut néanmoins éviter l’écueil qui les cantonne à l’indignation et privilégie les pressions sur l’opinion publique. En effet, leurs actions ont plusieurs fonctions :
Une fonction juridictionnelle : devant les tribunaux, les acteurs civiques, à titre individuel ou collectif, peuvent défendre les droits des citoyens mais aussi
contribuer à l’améliorer le droit en général. La défense des droits est facilitée par exemple en France par la constitution de partie civile des associations ou aux Etats-Unis par les class actions
; quant à l’amélioration du droit, elle est assurée aux Etats-Unis, à travers les mémoires déposés au titre d’ami de la cour (amicus curiae), formule qui vient récemment
d’être admise devant le Conseil d’Etat français. De même l’organe de règlement des différends de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce accepte désormais les communications d’amici
curiae présentées par des ONG, qui ne sont pourtant pas reconnues comme des parties à la procédure.
Une fonction législative
: les acteurs civiques proposent parfois aussi des réformes des textes. Bien que cette participation au pouvoir législatif soit indirecte, elle contribue néanmoins à l’élaboration de nouvelles conventions et à
la mise en place de structures judiciaires ou juridictionnelles.
Dans bien des cas, les acteurs civiques sont à l’origine d’innovations majeures.
On citera par exemple la campagne symbolisée par la pyramide de chaussures dans plusieurs villes qui a, notamment en France, indéniablement contribué à l’élaboration de la convention interdisant les mines antipersonnel.
D’autres ONG ont piloté la création de la Cour pénale internationale ; d’autres ont influencé la signature du Protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet de serre. Le plus souvent c’est grâce
à la réunion de plusieurs associations en collectifs citoyens, que ces innovations ont été possibles. Ces collectifs, agissant comme de véritables aiguillons, deviennent aussi efficaces que les acteurs économiques
ou scientifiques. Ils compensent l’impuissance des Etats et renforcent la légitimité des experts. Leur présence préfigure un pouvoir législatif mondial, mais soulève la question de leur légitimité.
Doù la recherche de critères démocratiques. Il faudrait réussir à combiner trois types de critères : représentativité, indépendance, légitimité.
Se percevoir comme citoyen du monde est un vieux rêve. Kant et Kang Youwei avaient fait le même rêve, ou presque, à des époques (18ème et
19ème siècles) et en des lieux (Allemagne, Chine) radicalement différents, ouvrant la voie vers une Cité des droits. Ils ont, chacun à leur manière, imaginé le citoyen du monde. L’un et
l’autre étaient pourtant conscients de leur distance par rapport au monde réel. Or la mondialisation actuelle réactive le débat suscité par ces philosophes visionnaires. Mais la citoyenneté reste à consolider
à l’échelle européenne et à construire à l’échelle mondiale.
En ce qui concerne l’Europe, c’est dès l’origine
que Jean Monnet, dans son discours de Washington (le 30 avril 1952) avait marqué l’ambition première : " nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes". L’Union
européenne a ouvert la voie d’une multi-citoyenneté, en surajoutant la citoyenneté européenne à la citoyenneté nationale (Charte de l’UE, chap. V).
A l’échelle mondiale, où l’image de la démocratie comme " un lieu vide et pourtant actif " s’applique parfaitement car les acteurs civiques s’y activent sans véritable
statut officiel et selon une typologie fort hétérogène, Michel Foucault n’avait pourtant pas hésité à affirmer que, en fait sinon en droit,"il existe une citoyenneté internationale
qui a ses droits et ses devoirs et qui engage à s’élever contre tout abus de pouvoir, quel qu’en soit l’auteur, quelles qu’en soient les victimes. Après tout nous sommes tous gouvernés et à ce titre
solidaires".
En somme la citoyenneté européenne se cherche encore et la citoyenneté mondiale se devine à peine, tant que subsiste ce paradoxe
de la libre circulation des marchandises et des capitaux alors que les hommes sont arrêtés aux frontières. Toutefois, les initiatives concrètes qu’elles suscitent montrent déjà qu’il serait possible de concevoir
une citoyenneté "à plusieurs niveaux" en ce sens qu’elle coordonnerait les droits reconnus aux niveaux national, régional et mondial, et associerait les citoyens aux décisions les concernant, qu’il s’agisse de
leur pays, de leur région, ou de leur planète devenu Cité-Monde.
La formule saisissante du poète Edouard Glissant, "Agis
en ton lieu, penses avec le monde", deviendrait en quelque sorte la devise du citoyen du monde.
Esus
MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION A CE GRAND
PROJET EN FAVEUR DES GENERATIONS A VENIR
L'Espace républicain
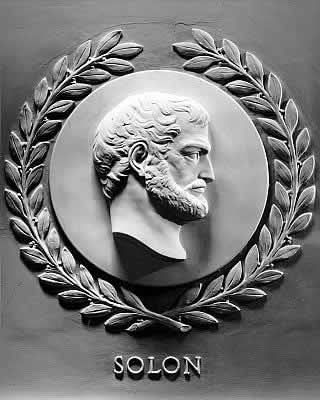
Derniers commentaires
le résumé est bien mais ça manque de détails de la bibliographie, date de l'article et du nom l'écrivain de cet article.
Clairement claire, j'ai apprécié
Le résumé est très bien fait.courge!
Le résumé est bien fait.